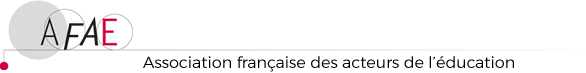Mois : août 2017
37e colloque national : L’autonomie pour quoi faire ?
L’autonomie, pour quoi faire ?
Rennes, les 27, 28 et 29 mars 2015
“Rendre autonomes élèves et étudiants est depuis toujours, de manière plus ou moins explicite, l’objectif des pédagogues qui fondent sur lui leur propre revendication d’autonomie. Plus récente est la volonté de faire des lieux d’apprentissage – avant tout supérieurs et secondaires – des établissements autonomes, dans un souci affiché d’efficacité et au nom d’un management, public ou privé, nouveau. Le cadre institutionnel ainsi que les outils supposés favoriser cette autonomie tout en la contrôlant, ont été progressivement mis en place au cours des dernières décennies. Les résultats sont-ils à la hauteur des ambitions ? Suffit-il d’améliorer l’existant ? Faut-il franchir de nouvelles étapes en matière de gestion des ressources humaines, d’articulation des projets locaux et territoriaux avec des programmes et des curriculums nationalement définis, d’évaluation des établissements, des équipes et des individus ? Doit-on repenser ces multiples autonomies à l’ère du numérique ? Mettent-elles en danger le pacte républicain ? Sont-elles une exigence démocratique ? “
Gérald CHAIX, ancien Recteur, Président du conseil scientifique du 37ème colloque national de l’AFAE
Pour aller plus loin :
- Consultez l’article “La problématique de l’autonomie des universités”, JP FINANCE (Président Honoraire de l’Université Henri Poincaré, Nancy, Conseiller pour l’Europe de la Conférence des président d’Université)
- Consultez l’article “Les autonomies” de JC TORRES (Chef d’établissement, Limoges)
34e colloque national : Enjeux internationaux pour les professionnels de l’éducation : mieux connaître pour mieux agir
Enjeux internationaux pour les professionnels de l’éducation : mieux connaître pour mieux agir
Strasbourg, 16, 17 et 18 mars 2012
Qu’il s’agisse de la construction européenne, de l’impact des grandes enquêtes internationales de type PISA, de la circulation au-delà des frontières d’idées relatives à l’éducation – mais qui sont parfois originaires d’autres horizons politiques ou économiques – ou même des compétences nécessaires à nos élèves face à un marché du travail fortement internationalisé, des questions liées à des perspectives internationales font de plus en plus souvent irruption au cœur de nos pratiques professionnelles. A la clé, se trouve aussi la question du positionnement du système éducatif français en Europe et dans le monde : est-il si différent qu’on le perçoit souvent ? Si oui, que penser de ces différences ? Faut-il s’interroger sur l’héritage d’une exception française en éducation, avec un devoir d’inventaire informé de ce que d’autres systèmes sont ou réalisent ? Ne faut-il pas aussi se demander si l’éducation française, ses acteurs comme ses chercheurs, sont suffisamment présents – pour s’exprimer comme pour écouter – dans les divers cadres internationaux où se discutent et se travaillent des stratégies, des recherches, des idées relatives à l’éducation au futur ?
Roger-François GAUTHIER et Alain BOUVIER (Présidents du Conseil scientifique du colloque 2012)
36e colloque national : Peut-on réformer l’école ?
Peut-on réformer l’école ?
Versailles et Marly-le-Roi, 04, 05 et 06 avril 2014
Peut-on réformer l’École ? Pourquoi cette question puisque l’École ne cesse d’être réformée depuis un demi-siècle, de la loi Edgar Faure à celle de Vincent Peillon ? La question est cependant pertinente car, chacun en a conscience, toutes ces réformes n’ont pas permis d’atteindre les objectifs visés par leurs concepteurs. . Le ‘‘mammouth’’ cher à Claude Allègre a su résister . La réforme de l’école reste à faire.
Christian PHILIP (Ancien recteur, Président du Conseil scientifique du colloque 2014)
Le Programme
33e colloque national : École et société : tensions et mutations
École et société : tensions et mutations
Nîmes, 1er, 2 et 3 avril 2011
Composante de la Société, l’École prépare certaines des mutations futures en formant les citoyens de demain. Parce que la finalité, le sens et l’intérêt donnés à ces mutations varient dans leur interprétation, parce que les vitesses de mutation ne sont pas les mêmes, ce dialogue est source de tensions. Ces tensions permettent d’envisager plusieurs scenarii qui, passant par l’immobilisme,vont de la rupture à une dynamique positive.
Il serait trop simple d’opposer une Société dynamique en perpétuelle mutation dans des temps courts à une École s’inscrivant dans la permanence des savoirs et le temps long de la formation des jeunes. L’École mute dans les contenus enseignés, comme dans les méthodes pédagogiques. Elle mute aussi avec la société dans les relations des adultes avec les enfants, des enseignants avec les parents, des adultes entre eux. Mais il s’avère qu’elle est parfois bousculée par la vitesse et les exigences de la société désormais habituée à des affichages immédiats des réponses.
Quels sont les points de convergence et de divergence entre l’École et la Société ? Si l’École apprend de la société et prépare la société future, est-elle en mesure d’inventer des modèles ?
35e colloque national : Vers quelles organisations scolaires à l’heure du numérique ?
Vers quelles organisations scolaires à l’heure du numérique ?
Lille, 22, 23 et 24 mars 2013
En 2013, le numérique fait partie de la société et s’impose à l’Ecole. Il est urgent de mieux comprendre les changements induits par cette acculturation à de nouveaux outils et technologies ; ils interrogent l’organisation des systèmes scolaires et leur pilotage. L’AFAE a déjà consacré des numéros de sa revue à la question de la culture numérique en 2008 et 2011, elle entend s’interroger, dans son prochain colloque, sur les organisations susceptibles de répondre aux nouvelles exigences et contraintes de l’école à l’ère du numérique.
Pédagogique, administratif, d’information ou documentaire, tous les domaines sont concernés par les transformations induites par le numérique et qui pèsent sur l’efficacité de la structure. L’enseignement et l’apprentissage sont bouleversés par les sources d’information multiples ainsi que par le nomadisme des outils qui changent le rapport au savoir et à l’enseignement ; le domaine administratif connaît également de multiples évolutions dans sa gestion des actes quotidiens ; le système d’information devient un outil d’aide à la prise de décision ; la création de sites internet d’établissement met en place des outils internes et oblige à s’interroger sur le rapprochement entre l’information interne et la documentation. Tout oblige à repenser la chaîne d’autorité et de validation.
Les chefs d’établissement et inspecteurs sont dès lors, directement concernés et leur place est essentielle puisqu’ils ont à piloter dans le quotidien de l’action tous les acteurs de ces nouvelles configurations : collectivités territoriales, parents, organisation scolaire, les partenaires sont multiples dans ces situations complexes que les contraintes et rapports de pouvoir complexifient encore davantage.
Le colloque de mars 2013 veut aider à s’interroger sur les modes de pilotage de proximité et sur les éventuelles évolutions de l’organisation scolaire, nécessaires pour répondre à ces nouvelles donnes.
Pour aller plus loin :
Pour un humanisme numérique – L’écrit à l’ère numérique par Sébastien Rongier, Camille de Toledo, Cécile Portier, Denis Bruckmann
Dossier d’actualité Veille et Analyses : Inspection scolaire : du contrôle à l’accompagnement ? n°67, novembre 2011 Auteur(s) : Rémi Thibert
32e colloque national : Équipe de direction, équipe enseignante
Équipe de direction, équipe enseignante
Bordeaux, 26, 27 et 28 mars 2010
Équipe de direction, équipe enseignante : à partir de la question des représentations et des attentes que les différents acteurs ont les uns des autres et au-delà des tensions entre les sphères pédagogiques et administratives, la réflexion se dirigera vers la recherche des conditions d’une action commune des équipes pour une meilleure efficacité du système éducatif et pour le développement de relations humaines de qualité. Car si l’objectif affirmé de part et d’autre est de permettre la réussite de tous les élèves, il reste à s’interroger sur les moyens d’y parvenir ensemble.
Justement : de quelles équipes parle-t-on ? Si le principe du singulier (de l’unité ?) d’une équipe de direction semble acquis a priori, encore faudra-t-il s’appliquer à en décrire les facteurs de cohésion et à en délimiter les contours : dans le premier degré, qui assume réellement la direction en dehors de l’IEN ? Dans le second degré, où situer les CPE, les professeurs documentalistes ou encore les chefs de travaux, personnels dont le statut est proche des enseignants mais que leurs fonctions et services inscrivent dans l’orbite de la direction ? Et que dire de l’ « équipe enseignante » : une équipe, des équipes ?
L’établissement scolaire est le lieu où s’affirment en même temps la revendication d’une « liberté pédagogique » et la nécessité d’administrer en respectant des règles et des lois. Il apparaît dans ce cadre comme une entité en quête de diverses conciliations : conciliation des temporalités (temps des enseignants, de la direction, des corps d’inspection, des instances administratives centrales comme déconcentrées…), conciliation des acteurs (autour de méthodes et d’objectifs), démarche de projet, (pilotage partagé, expérimentation, élaboration de stratégie d’établissement en matière d’objectifs à atteindre et de dispositifs d’évaluation)…
Quelles sont les voies, -certifiées ou restant à explorer-, qui sont susceptibles d’installer les conditions d’un travail en commun au sein de l’EPLE et des circonscriptions ? Comment les systèmes éducatifs des pays voisins abordent-ils la question ?
31e colloque national : De l’orientation à l’insertion, la formation face à la mondialisation
De l’orientation à l’insertion, la formation face à la mondialisation
Amiens, 20, 21 et 22 mars 2009
Suite aux nombreux débats sur l’orientation, le projet de chaque élève face au marché du travail semble prioritaire. L’insertion est désormais considérée dans une vision globale de formation du futur citoyen. Pour cette raison, l’École et l’université s’interrogent sur l’employabilité de leurs diplômés. Après avoir, jadis, limité la formation dite “professionnelle” à celle des ouvriers, l’analyse actuelle conduit à reconnaître la professionnalité d’un médecin, d’un enseignant ou d’un ingénieur et de leur formation. À l’université, les Masters professionnels se multiplient. À court ou moyen terme, chaque élève devra donc suivre une telle formation professionnelle. Un nouveau cadre se dessine : la formation tout au long de la vie et la diversité des parcours sont désormais des réalités qui doivent être prises en compte dans toute orientation. Par ailleurs, la volonté de créer un espace éducatif européen est de plus en plus prégnante : mise en cohérence des systèmes de certification, reconnaissance mutuelle de diplômes, création de programmes incitant à la mobilité internationale, évaluation des systèmes de formation sur la base d’indicateurs partagés. De plus, l’économie mondiale impacte les objectifs des systèmes éducatifs, en particulier, pour le nôtre, dans l’usage des diplômes professionnels, du CAP au titre d’ingénieur. En Europe, la co-évaluation des diplômes est annoncée pour 2010. Les lois de décentralisation et la déconcentration des services de l’État font aujourd’hui de l’échelon régional celui de la mise en oeuvre des politiques publiques d’orientation, de formation et d’insertion, avec un affichage d’objectifs régionaux, nationaux et internationaux. De plus le développement de l’apprentissage, la multiplicité des acteurs de la formation et la concurrence des dispositifs rendent peu lisibles les parcours possibles. Tout cela pose la question de la gouvernance du système en vue d’améliorer la formation et l’insertion des élèves comme des adultes. Les contenus de formation, la mise en oeuvre dès l’école primaire d’une approche par les compétences, la lutte contre les sorties sans qualification, le développement de l’apprentissage public ou l’individualisation des parcours et des pédagogies pour les élèves, les apprentis et les adultes sont donc questionnés. L’Éducation nationale, en particulier les EPLE et les chefs d’établissement, est amenée à s’interroger sur la façon d’améliorer l’orientation dans une perspective mondiale de formation tout au long de la vie. Les évolutions envisagées renvoient à la gestion des ressources humaines : comment recruter, former et accompagner les personnels ? Éclairées par les évolutions internationales, ces questions seront posées d’abord sous forme d’un état des lieux, puis à la recherche d’évolutions souhaitables. Les voix diverses qui se feront entendre – la parole sera donnée à des cadres et des enseignants, aux parents d’élèves, aux universités, à d’autres acteurs de l’État, à des Conseils régionaux, aux entreprises, aux chambres consulaires et aux partenaires sociaux – permettront d’aborder cette thématique dans toute sa richesse et sa complexité.
Nous tenterons ainsi de dégager les principaux enjeux de la formation initiale et professionnelle dans un système éducatif dont l’ambition est de permettre l’insertion et l’épanouissement personnel des citoyens de demain, et leur adaptabilité à une société en constante mutation.
Alain BOUVIER, Président de l’AFAE, Membre du Haut Conseil de l’Éducation
30e colloque national : École et collectivités territoriales : nouveaux enjeux, nouveaux défis
École et collectivités territoriales : nouveaux enjeux, nouveaux défis
Nantes, 04, 05 et 06 avril 2008
À l’occasion de son 30e colloque national, l’AFAE, lieu de libres discussions et véritable laboratoire d’idées, se propose d’approfondir la question des rapports entre l’École et les collectivités territoriales : bilans, premiers éléments de réponse, nouvelles questions, nouveaux enjeux, nouveaux défis, nouvelles perspectives.
Est-on au clair sur le partage des responsabilités avec les collectivités territoriales ? Jusqu’à quel point et dans quelle direction cette évolution va-t-elle se poursuivre ? À l’heure de la remise en question de la carte scolaire dans la majorité des pays de l’OCDE, comment sont gérées en France les inégalités : inégalités territoriales d’une part, inégalités sociales et scolaires de l’autre ? Les collectivités répondent-elles mieux à ces questions que l’État ? Quelles interventions souhaiter des collectivités pour réduire les inégalités sociales ? Et quelles actions attendre de l’État pour réduire les inégalités territoriales ?
La décentralisation a changé le rôle des partenaires éducatifs : en quoi a-t-elle modifié les responsabilités du chef d’établissement et produit-elle un nouveau type de manager ? En quoi la décentralisation, son acte II et le transfert des techniciens ouvriers de service (TOS) modifient-ils le rôle des gestionnaires d’EPLE ?
Si chaque EPLE est lié à l’État et à une collectivité territoriale, peut-on pour autant en déduire qu’il est sous une double tutelle ? Les EPLE ont mis plus de vingt ans à s’approprier, non sans mal, les démarches de projet. Ils doivent aujourd’hui signer un contrat d’objectif avec l’État et une convention avec leur collectivité de rattachement. Quelles nouvelles pratiques voit-on émerger ? Comment et à qui les collectivités demandent-elles des comptes sur les résultats ? À quelles évaluations procèdent-elles déjà et quelles extensions envisagent-elles ? Vers quel nouveau paysage se dirige-t-on ?
La région a la maîtrise du plan régional de formation professionnelle (PRDFP) et intervient dans sa mise en oeuvre effective. Quelles sont les incidences sur la formation initiale et continue dispensée dans les lycées professionnels ? Quelle approche territoriale des formations discerne-t-on, notamment dans le rapport à l’emploi et l’insertion professionnelle ?
Nous avons choisi de donner la parole à des cadres de l’Éducation nationale, mais aussi à des responsables issus de conseils régionaux, de conseils généraux et de municipalités. Ils sont devenus par les lois de décentralisation de véritables partenaires du système éducatif et souhaitent maintenant davantage en termes de gouvernance : devenir des parties prenantes. Le point de vue d’homologues internationaux viendra enrichir les débats. Ces voix diverses permettront d’aborder le thème des rapports entre l’École et les collectivités territoriales dans toute sa richesse et sa complexité.
Outre l’assemblée générale annuelle de l’association qui se tiendra à cette occasion et nous donnera l’opportunité de présenter à nos adhérents nos récentes réalisations et nos ambitieux projets, ce colloque nous permettra de fêter le 30e anniversaire de notre association et d’en réaffirmer l’identité, les valeurs et les objectifs pour demain.
Alain Bouvier, président de l’AFAE, membre du Haut Conseil de l’Éducation
29e colloque national : Réussite des élèves, performances des établissements
Réussite des élèves, performances des établissements
Marly-Le-Roi, 16, 17 et 18 mars 2007
Qu’est-ce en définitive que réussir à l’école ? Un élève réussit-il quand il a de bons résultats ? Quand il décroche des diplômes ? Quand il choisit des filières et des établissements valorisés ? Quand il s’insère avec succès dans le monde professionnel ? Quand il a les compétences requises pour faire évoluer sa carrière professionnelle tout au long de sa vie ?
Qu’est-ce qu’un établissement performant ? Un établissement où les élèves s’épanouissent, se forment à la citoyenneté et aux exigences de la vie collective ? Où les élèves réussissent aux examens ? Mais est-ce la même chose de voir ses élèves réussir, lorsqu’on les a, d’une manière ou d’une autre, sélectionnés parmi les meilleurs ou lorsqu’on les accueille en fonction de la carte scolaire ? La réussite des élèves est-elle le seul élément de performance d’un établissement ? La performance d’un établissement est-elle une condition de la réussite des élèves ?
La réussite comme la performance sont, actuellement, des impératifs indiscutables – et de ce fait, trop peu discutés – qui s’imposent aux personnes comme aux structures, à tous les niveaux de nos sociétés. L’enjeu du débat est de remettre de la pluralité dans le questionnement, de la discussion dans le diktat. Ce qui importe ici est le pluriel : il n’y a pas une mais des réussites, pas une mais des performances, comme il ne peut être question que des élèves et des établissements.
Il faut pour aborder ce sujet croiser les approches, multiplier les perspectives. Comment évoluent les mesures de compétences ? Comment la continuité ou les discontinuités du système éducatif influent-elles sur la réussite des élèves ? Comment un établissement contribue-t-il à la réussite de ses élèves : par la création d’un « climat » favorable ? Par le leadership d’un chef d’établissement ? Par les marges de manœuvre, en terme d’innovation pédagogique, par exemple, que lui offre son autonomie ? En quoi l’inscription de l’établissement dans un paysage partenarial et un réseau social contribue-t-elle à sa performance et à la réussite des élèves ? Comment analyser les écarts de performances entre établissements ? Comment définir les indicateurs de performances ? La LOLF changera-t-elle la nature de cette performance et les outils qui la mesurent ? Comment situer l’établissement par rapport aux attentes de résultats de la tutelle académique et des collectivités territoriales ? La réussite des élèves étant au cœur du projet éducatif, aussi bien au niveau individuel que collectif, tout ce qui peut être mis en œuvre pour la favoriser doit être questionné.
Ce XXIXe colloque national de l’AFAE sera une nouvelle fois l’occasion de susciter le débat autour de questions qui sont au cœur des objectifs de l’École et de chacun de ses acteurs et partenaires. Les voix diverses qui se feront entendre – élèves, parents d’élèves, chefs d’établissements, inspecteurs, cadres du Ministère de l’Éducation nationale, ou des collectivités territoriales, chercheurs, responsables associatifs – permettront d’aborder le thème dans toute sa richesse et sa complexité, par des conférences, tables rondes, ateliers et regards croisés, en ayant à cœur d’œuvrer à rendre plus efficace le service public d’éducation, condition de réussite des élèves.
Alain Warzée, Président de l’AFAE, Inspecteur général de l’Éducation nationale